Les marchés publics, terrain de jeu de la corruption locale
Élu il y a deux ans dans une commune marquée par un scandale de corruption immobilière, le maire de Saint-Jory

À l’heure où les fondements de la mondialisation vacillent, où les flux migratoires deviennent des leviers géopolitiques et où l’intelligence artificielle redéfinit le travail, l’économiste Branko Milanovic revient sur une décennie de réflexions. Il explore les mutations du capitalisme, les inégalités persistantes, le rôle croissant des États et les tensions entre protectionnisme et ouverture. Une analyse lucide et sans filtre des bouleversements en cours. Connu comme l'un des plus grands experts mondiaux des inégalités mondiales, il a longtemps été économiste en chef à la Banque mondiale (1993-2001), est senior scholar au Luxembourg Income Study Center (LIS) et visiting presidential professor à la City University of New York (CUNY).
Pourquoi avez-vous choisi d’écrire ce livre sous forme de courts essais plutôt que sous forme d’un grand ouvrage théorique, comme vous l'avez fait auparavant ?
J’ai vraiment eu une grande liberté dans ce projet. Il s’agit d’un recueil d’écrits que j’ai rédigés au cours des dix dernières années, peut-être plus. C’est l’éditeur et moi qui avons eu l’idée de rassembler ces textes : de courts essais, parfois des réflexions plus brèves, publiés ici ou là. L’objectif était d’en faire un ouvrage que l’on puisse lire librement, dans n’importe quel ordre.
Le premier texte traite de la décroissance, puis on passe à des sujets comme les migrations, l’histoire de la pensée économique... On y croise des auteurs comme Ricardo, Marx, Keynes. Il y a un peu de tout, ce qui permet, je pense, à chacun d’y trouver quelque chose d'intéressant. C’est aussi une façon d’illustrer une période de temps. Chaque texte est daté, et aucun n’a été modifié. Si un texte date de 2015, il a été écrit tel quel en 2015. Il peut donc comporter des erreurs de prévision, mais c’est important pour moi que le lecteur ait accès à la pensée dans son contexte d’origine.
Vous montrez que les inégalités persistent mais évoluent. Selon vous, la mondialisation a-t-elle atteint un seuil irréversible ?
La forme de mondialisation que nous avons connue depuis la fin des années 1980-90 semble toucher à sa fin. Ce n’est pas uniquement lié à Trump et à sa politique protectionniste : cela a commencé avec sa première administration et s’est poursuivi sous Biden. On le voit aussi en Europe, avec une politique contre la Chine.
Il y a également la question migratoire. Dans la logique néolibérale, la libre circulation des travailleurs fait partie intégrante de la mondialisation, au même titre que celle des capitaux. Or, cette liberté de mouvement n’a jamais été totalement effective : le capital a toujours été plus libre que le travail. Théoriquement, on ne doit pourtant pas les distinguer. Aujourd’hui, les restrictions sur les migrations s’accompagnent de barrières commerciales et d’une diminution progressive des flux de capitaux. Ces trois dynamiques indiquent que nous nous éloignons nettement du modèle globalisant tel qu’il existait auparavant.
Le contrôle des flux migratoires devient-il un levier géopolitique ?
Absolument, c’est un instrument politique à part entière. Le capitalisme suppose la mobilité du capital, souvent au détriment de la main-d’œuvre locale. Les entreprises vont là où le coût du travail est plus faible. Contrôler les migrations permet de maintenir des frontières économiques tout en continuant à délocaliser. Les deux dimensions – mobilité du capital et immobilité du travail – sont liées, et on ne peut pas les analyser séparément.
Les modèles économiques chinois et américain convergent-ils ou s’opposent-ils ?
C’est une question complexe. J’ai défini dans Le capitalisme sans rival le système chinois comme un capitalisme politique ou un capitalisme d’État – un terme que Max Weber utilisait déjà. Ce modèle n’est pas équivalent au capitalisme libéral américain. En Chine, l’État conserve un rôle prépondérant, y compris dans le secteur privé. Le pouvoir du Parti communiste est manifeste. Je ne crois pas à une véritable convergence.
Cela peut sembler paradoxal, mais si l’on pense au XIXe siècle, il existait encore des systèmes fondés sur le travail forcé – qui n’étaient pas capitalistes. Le capitalisme implique du travail libre, contractuel, sans coercition extra-économique. On pense à l’esclavage aux États-Unis, qui a duré jusqu’en 1865, au servage en Russie jusqu’en 1861, à l’esclavage au Brésil jusqu’en 1888, ou encore dans les colonies britanniques où la traite a été abolie seulement au début du XIXe siècle. Ces systèmes différaient du capitalisme.
Puis, à partir de 1917 avec la révolution russe, un système non capitaliste a existé pendant plusieurs décennies. Depuis la chute du communisme, il n’y a plus d’alternative structurée. La Chine, à mon sens, reste un capitalisme d’État, donc un capitalisme, même s’il est différent. En Occident, le rôle de l’État a certes augmenté – on parle aujourd’hui de politiques industrielles –, mais cela reste très différent de l’interventionnisme structurel chinois.
Le protectionnisme peut-il être vu comme une opposition au capitalisme globalisé ?
Le protectionnisme accroît naturellement le rôle de l’État, c’est incontestable. Mais cela ne signifie pas qu’il y ait convergence entre la Chine et les États-Unis. Dans le système chinois, l’État conserve une position centrale. On l’a vu récemment avec une réunion entre Xi Jinping, les dirigeants du Parti, et les plus grands chefs d’entreprise. Il n’y avait aucun doute sur qui avait le pouvoir : les représentants du Parti étaient au centre, les entrepreneurs assis en périphérie. Cela illustre bien que le pouvoir économique est dans les mains de l’État. Les banques, la finance, tout cela reste contrôlé. Ce n’est pas le cas en Occident.
Ces politiques de relocalisation sont parfois qualifiées de néo-mercantilistes. Quel impact peuvent-elles avoir sur les inégalités mondiales ?
Je ne voudrais pas sous-estimer le rôle du néo-mercantilisme. Dans un essai récent, j’analysais la politique de Trump comme une combinaison de deux tendances apparemment contradictoires : d’un côté, un néolibéralisme renforcé sur le plan domestique (réduction des impôts sur les riches, dérégulation), et de l’autre, un mercantilisme clair sur le plan international. Les deux peuvent coexister. On pense parfois que le mercantilisme suppose plus d’intervention de l’État au niveau national, mais ce n’est pas nécessairement le cas.
Concernant les inégalités mondiales, il est très difficile de dire aujourd’hui ce que cela produira. Les relations d’échange entre la Chine et les États-Unis sont en pleine mutation. J’ai vu récemment qu’il n’y avait plus de navires marchands chinois dans le port de Seattle, alors qu’il y en avait énormément encore récemment. Si cela continue, on pourrait revenir à une situation antérieure à la normalisation des relations sino-américaines. Mais à l’époque, la Chine n’avait pas encore l’importance économique qu’elle a aujourd’hui. Aujourd’hui, la Chine et les États-Unis représentent plus de 40 % du PIB mondial. S’ils cessent de commercer, les conséquences seront considérables.
Peut-on envisager un modèle hybride entre capitalisme d'État et capitalisme libéral ? Et quel rôle l’intelligence artificielle jouera-t-elle sur le marché du travail et les inégalités ?
On évoque souvent un modèle hybride, mais je reste prudent. Concernant l’intelligence artificielle, l’impact sur le marché du travail reste incertain. Ce que l’on peut dire, c’est qu’en principe, elle augmente l’importance du capital dans la production. Et puisque le capital est inégalement réparti, cela risque d’accroître les inégalités. C’est l’analyse dominante aujourd’hui. Cela dit, de nouvelles formes d’emploi peuvent émerger, comme ce fut le cas avec l’arrivée d’Internet. Il existe beaucoup d’inconnues. Tout dépendra de la manière dont les sociétés s’adaptent à ces transformations.
Les sanctions économiques, les restrictions sur les technologies stratégiques (comme les semi-conducteurs) : selon vous, ces outils sont-ils réellement efficaces pour ralentir l’ascension économique d’un rival, ou tendent-ils à redessiner un autre ordre commercial ?
Ces sanctions, contre la Russie d’abord, puis contre la Chine, sont un renversement du principe même de mondialisation et de libre-échange. Les sanctions américaines, qui touchent aujourd’hui plus de 50 pays et des milliers de personnes, rendent obsolète l’idée d’un marché global fluide.
Quant à leur efficacité, notamment envers la Chine, cela reste incertain. Prenez l’exemple des puces électroniques : les sanctions ont parfois produit l’effet inverse. Elles ont accéléré le développement technologique chinois, qui atteint désormais un niveau tel qu’il devient très difficile de l’endiguer par ce moyen. Les sanctions peuvent donc avoir un effet contraire à celui escompté. L’idée d’un libre-échange généralisé est aujourd’hui remise en cause, y compris par les pays qui l’ont longtemps défendue.
La montée d’autres pays émergents comme l’Inde ou l’Indonésie signe-t-elle l’arrivée d’un monde multipolaire ?
Oui, et ce n’est pas un phénomène secondaire. La Chine est évidemment centrale, mais d’autres pays comme l’Inde, l’Indonésie, la Thaïlande ou le Vietnam jouent un rôle croissant. Cela bouleverse complètement l’économie mondiale. J’en parle aussi dans mes travaux sur les inégalités globales. C’est, en quelque sorte, l’inverse de la révolution industrielle : celle-ci avait creusé les inégalités mondiales, avec la montée de l’Occident – d’abord l’Europe, puis l’Amérique du Nord, et enfin le Japon. Avant la révolution industrielle, au XVIIIe siècle, les inégalités globales étaient limitées : les revenus en France étaient, au maximum, deux fois plus élevés qu’en Chine. Après, l’écart a explosé : jusqu’à quinze fois plus.
Aujourd’hui, la montée de l’Asie réduit cet écart. C’est donc une inversion historique. Ce mouvement entraîne aussi la désindustrialisation de l’Occident, comme la colonisation anglaise avait entraîné la désindustrialisation de l’Inde. Il existe de nombreux parallèles. Nous assistons à une révolution technologique qui reconfigure la carte du monde, bien au-delà de la Chine seule.
Vous montrez qu’historiquement, les grandes inégalités ont souvent été à l’origine de ruptures sociales violentes. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans une phase pré-révolutionnaire ?
Je pense que nous sommes dans une phase pré-révolutionnaire. Et c’est pour cette raison qu’il est très difficile de faire des projections, parce qu’une dizaine de variables changent en même temps. Je pense qu’il y a trois choses qui me semblent évidentes.
Premièrement, la dominance du capitalisme est très claire, très nette, et va continuer. Deuxièmement, la montée de la Chine et de l’Asie change vraiment la carte géographique du monde d’une manière irréversible. Et troisièmement, cela signifie qu’il y a, en vérité, une polarisation du monde qui monte — une polarisation qui n’existait pas il y a 30 ans. Donc, on voit un monde qui devient multipolaire. Mais sur le capitalisme, je ne pense pas qu’il y ait de changement radical. Ces deux forces sont très fortes, et je ne vois pas, d’ici à 50 ans, que cela puisse changer.
Faut-il s’attendre à une provincialisation progressive de l’Occident dans l’économie mondiale ?
Pas de l’Occident, mais de l’Europe. Je ne pense pas que l’Amérique et l’Europe soient les mêmes. L’Amérique est beaucoup plus importante — c’est un seul pays. De plus, la population américaine continue d’augmenter, alors que la population européenne stagne. Politiquement, l’Europe n’a pas assez de force ou de volonté pour favoriser l’immigration, qui est pourtant nécessaire d’un point de vue économique, mais qui pose d’énormes problèmes politiques. L’anti-immigration est devenue le premier thème utilisé comme politique. Donc, on peut dire qu’il y a comme une série de cartes jouées contre l’Europe — et l’Amérique aussi, mais pas nécessairement politiquement de la même manière. Je pense que leurs destins économiques sont différents.
Vous proposez une observation assez lucide, mais vous restez réservé sur les prescriptions politiques. Est-ce un scepticisme sur le capitalisme en général ?
Je viens de le dire : il y a trois choses qui me semblent très claires. Malgré l’ambiguïté sur l’avenir, je pense que l’une de ces trois choses, c’est la dominance du capitalisme. Et quand je parle de la dominance du capitalisme, ce n’est pas seulement dans les entreprises ou le travail. Le capitalisme est entré dans notre vie privée.
C’est très important : la marchandisation. Quand vous louez votre appartement à quelqu’un que vous ne connaissez pas, c’est la marchandisation de l’appartement — ce qui n’existait pas il y a 15 ou 20 ans. Quand vous prenez votre voiture pour en faire un outil de capital — alors qu’avant, c’était simplement pour aller en vacances ou ailleurs —, vous la transformez en capital. Ça, c’est un changement de discours fondamental. Cela signifie que vous vendez votre droit à utiliser librement votre voiture. En fait, énormément de choses qui n’étaient pas auparavant des objets marchands le deviennent. Ce ne sont pas seulement des marchandises au sens marxiste ; ce sont des éléments de vie privée qui deviennent des marchandises.
C’est pour ça que je pense que le capitalisme est entré dans notre vie privée. Il reflète des éléments très capitalistes, et je pense qu’on est arrivé à un point où, même les fonctions de la famille sont totalement marchandisées. C’est déjà le cas : on a des établissements où l’on s’occupe des personnes âgées ou des enfants. Pour les chiens aussi : il y a des gens qui sont payés pour s’occuper des chiens, pour les promener, parce que leurs propriétaires n’ont pas le temps. Tout cela est devenu marchand. Cela est entré dans notre vie privée de manière extraordinaire.
Et vous pensez que c’est un danger pour nos démocraties ?
Je ne pense pas qu’il y ait une relation très nette entre la marchandisation des fonctions privées et la démocratie. Il me semble qu’on pourrait peut-être y voir un danger dans le fait que les gens n’ont plus le temps de s’occuper des affaires politiques. Il y a une citation qui dit que le socialisme est une très belle chose, mais qu’il prend trop de temps. Parce que si vous aimez le socialisme, il faut discuter de tout, tout le temps, à tous les niveaux.
Même dans une démocratie capitaliste, il faut avoir du temps pour connaître les dossiers, les affaires, etc., et ensuite participer à la vie politique. Mais avec le capitalisme, la majorité de votre temps est prise par le travail, pour gagner de l’argent, et pour montrer aux autres que vous en gagnez. Cela signifie que vous n’êtes plus une personne capable de vous occuper des affaires publiques. Donc oui, cette grande marchandisation peut avoir des effets néfastes.
Récemment vous affirmiez qu’il n’y avait pas de manque de ressources, mais que l’idéologie et les conflits entre puissances poussaient au pessimisme.
Oui, je pense que le livre, que je citais, est excellent [Le monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude, Arnaud Orain, ndlr]. Ce qui m’a plu est qu’il ne parle pas du capitalisme de façon directe, mais de ce que j’appelle un réalisme commercial — c’est-à-dire une alternance entre périodes de commerce armé et périodes de libre-échange. Ce balancier se transforme pour des raisons politiques.
Là où je ne suis pas d’accord avec Arnaud Orain, c’est vers la fin du livre. Je ne pense pas qu’on soit en train de se battre pour les ressources, parce qu’il y a soudainement un manque des resources. Des conflits de ressources, il y en a toujours eu. Ce n’est pas nouveau. On découvre même de nouvelles ressources : par exemple, avec le réchauffement climatique, l’Arctique devient économiquement exploitable — et ça pose des problèmes entre la Norvège, la Russie, la Chine, etc.
Je ne pense pas que le manque de ressources soit la question. L’idéologie a changé. On voit le monde différemment. Il y a 20 ou 30 ans, on pensait que tout le monde allait bénéficier du développement mondial. Mais on s’est rendu compte que ce n’était pas le cas : les classes moyennes occidentales ont beaucoup moins bénéficié que la Chine. Et on se dit maintenant : s’il n’y en a pas pour tout le monde, il y en aura moins pour moi. Et on finit par le traduire : s’il y en a plus pour vous, il y en aura moins pour moi.
Peut-on dire que les États ont perdu une partie de leur souveraineté économique de façon irréversible ?
Oui, je pense que c’est vrai. Mais ce n’est pas nouveau. On parle depuis longtemps du pouvoir des multinationales. Même avant la mondialisation actuelle, on en parlait. Je pense que, fondamentalement, l’État, même occidental — pas seulement la Chine —, peut encore imposer certaines choses. Les États-Unis l’ont montré, en dissuadant des entreprises d’aller investir en Chine. Le pouvoir étatique existe toujours. Il n’est pas toujours exercé, mais si l’État entre dans une logique de guerre économique, il peut encore agir.
Parmi toutes les observations de votre livre, laquelle vous semble la plus sous-estimée par le public ou les décideurs ?
Ce livre est une compilation de textes que j’ai écrits sur plusieurs années. À la fin, ce sont les observations sur la vie privée, la direction générale des choses, qui me semblent les plus importantes — pas nécessairement les observations économiques.
Par exemple, cette invasion du capitalisme dans la vie privée est très importante. Je pense qu’elle est sous-estimée. On n’a pas envie de la reconnaître, car elle est très critique de nous-mêmes. On voudrait croire qu’on garde une certaine liberté, qu’on est indépendant. Mais dès que nos décisions privées — nos choix de partenaires, par exemple — sont influencées par des logiques économiques, cela montre que ces préférences réduisent la mobilité sociale, etc.
Ces choses personnelles nous frappent plus que les dynamiques économiques abstraites. C’est la partie la moins citée du livre, mais elle soulève de vraies questions sur nous, comme êtres humains. Ce n’est plus seulement l’économie, c’est l’économie individualisée, psychologisée. Cette psychologie est, en grande partie, le résultat d’une socialisation à certaines valeurs — et ces valeurs sont très capitalistes.
Je me souviens d’un épisode — j’étais en Espagne à l’époque du mouvement des Indignados. Ce qui m’a frappé, c’est que, sur les places, les jeunes Espagnols discutaient, débattaient, organisaient des assemblées tous les soirs. Mais autour d’eux, il y avait une autre jeunesse — les jeunes immigrés, souvent du Maghreb ou d’Afrique. Eux étaient là pour vendre des choses : boissons, briquets, cigarettes. C’était deux groupes de jeunes, du même âge, mais ils n’avaient rien en commun. Les immigrés n’étaient pas invités à participer aux assemblées. Ça montre peut-être un problème dans le rapport à l’immigration, mais aussi un gouffre entre deux jeunesses.
Enfin, la partie de World Under Capitalism que je pense est aussi très importante est la critique des théories de décroissance.
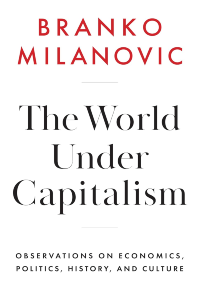
The World Under Capitalism: Observations on Economics, Politics, History, and Culture (English Edition) de Branko Milanovic, Polity Books, 11 avril 2025
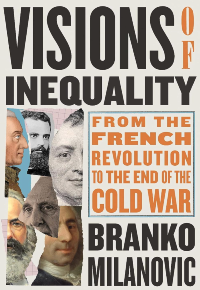
Visions of Inequality : From the French Revolution to the End of the Cold War, de Branko Milanovic, Belknap Press, 9 septembre 2025